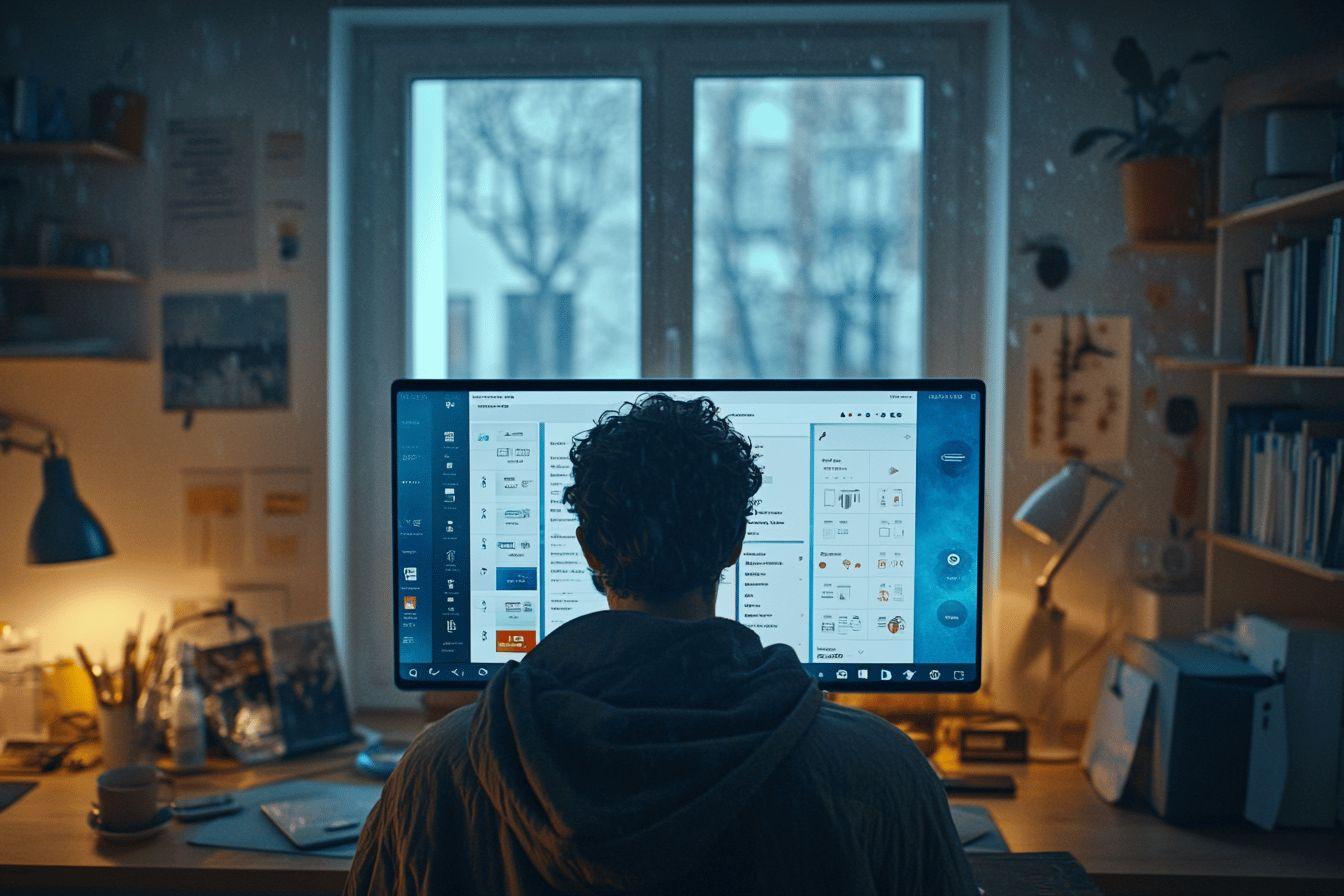Avant de découvrir Parcoursup, j’ai connu les dernières années d’APB comme conseiller d’orientation. Ce système a marqué toute une génération d’étudiants français. Te souviens-tu de ces longues soirées de juin passées à rafraîchir frénétiquement la page pour voir si une proposition était tombée? Pour comprendre cette procédure qui a révolutionné l’orientation post-bac en France, plongeons dans les détails de ce système aujourd’hui disparu mais qui reste une référence dans l’histoire de notre enseignement supérieur.
| Idées principales | Détails essentiels |
|---|---|
| 📌 Définition et contexte d’APB | Créée en 2009, cette plateforme nationale centralisait les inscriptions pour plus de 12 000 formations post-bac. |
| 🗓️ Calendrier et procédure | Formulation des vœux de janvier à mars, avec trois phases d’admission entre juin et juillet et une procédure complémentaire. |
| 🧮 Fonctionnement de l’algorithme | Basé sur la théorie des « mariages stables« , nécessitant un classement obligatoire des 24 vœux maximum par ordre de préférence. |
| ⚠️ Controverses et limites | Manque de transparence et recours au tirage au sort dans les filières en tension comme STAPS ou droit. |
| 🔄 Évolution vers Parcoursup | Suppression de la hiérarchisation des vœux, réduction à 10 vœux et abandon du tirage au sort en 2018. |
| 🏛️ Système précédant APB | Inscriptions individuelles par correspondance ou sur place, créant des inégalités territoriales et des files d’attente interminables. |
APB : définition et objectifs du système d’orientation post-bac
APB, acronyme d’Admission Post-Bac, était une plateforme nationale de préinscription dans l’enseignement supérieur français qui a fonctionné de 2009 à 2017. Ce portail numérique centralisait les démarches d’inscription pour les formations post-baccalauréat, simplifiant considérablement le parcours des lycéens vers les études supérieures.
L’histoire d’APB commence modestement en 2002, lorsque le système fut créé pour faciliter uniquement les inscriptions en classes préparatoires. Son succès a conduit à son extension progressive à l’ensemble des formations post-bac dès 2009. Cette évolution m’a toujours rappelé celle de nos grands classiques littéraires, d’abord confidentiels avant de s’imposer largement.
La plateforme s’adressait principalement aux élèves de Terminale et aux bacheliers de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire dans l’enseignement supérieur. À l’époque, ce système constituait une véritable révolution par rapport aux méthodes antérieures d’inscription, marquant une rupture avec les démarches individuelles multiples auprès de chaque établissement.
Les formations concernées par APB
APB regroupait plus de 12 000 formations différentes, donnant accès à un large éventail d’options pour les futurs étudiants :
- Les licences universitaires (L1) et la PACES pour les études de santé
- Les filières sélectives comme les BTS, DUT, CPGE et écoles d’ingénieurs post-bac
- Les écoles de commerce accessibles après le baccalauréat et les écoles d’architecture
Pourtant, certaines formations restaient hors du système APB, comme plusieurs écoles privées, les IEP (Sciences Po), l’université Paris-Dauphine ou encore la majorité des écoles du secteur social et paramédical.
Les étapes clés de la procédure APB : de l’inscription à l’admission
La procédure APB suivait un calendrier précis que j’expliquais méticuleusement à chaque promotion de terminale. Elle débutait en janvier pour s’achever généralement en septembre de la même année.
Le calendrier détaillé
La première phase d’inscription et de formulation des vœux se déroulait du 20 janvier au 20 mars. Les candidats créaient leur dossier sur le site www.admission-postbac.fr et formulaient jusqu’à 24 vœux qu’ils devaient impérativement classer par ordre de préférence.
Suivait ensuite la constitution et l’envoi des dossiers jusqu’au 2 avril. Les lycéens confirmaient leur liste de vœux et transmettaient les documents demandés par chaque formation.
Les phases d’admission constituaient le moment crucial de la procédure :
- Première phase (8 juin) : première vague de propositions
- Deuxième phase (23 juin) : nouvelles propositions pour les candidats sans affectation
- Troisième phase (14 juillet) : dernières propositions dans le cadre de la procédure normale
Face aux propositions d’admission, quatre réponses étaient possibles : « Oui définitif » pour accepter définitivement une formation, « Oui mais » pour accepter provisoirement tout en espérant mieux, « Non mais » pour refuser tout en maintenant les vœux mieux placés, ou « Démission générale » pour se retirer complètement de la procédure.
Une procédure complémentaire existait du 24 juin au 9 septembre pour les candidats n’ayant reçu aucune proposition ou s’étant inscrits tardivement.
L’algorithme d’APB : comprendre son fonctionnement et ses controverses
Le cœur d’APB reposait sur un algorithme inspiré des travaux mathématiques de Gale et Shapley sur les « mariages stables« . J’ai toujours trouvé intéressant que des théories mathématiques puissent ainsi déterminer l’avenir académique de milliers de jeunes.
Cet algorithme visait à optimiser l’affectation des candidats selon leurs préférences et les capacités d’accueil des formations. La hiérarchisation obligatoire des vœux constituait la pierre angulaire du système : l’algorithme cherchait à affecter chaque bachelier à son vœu le mieux classé possible.
Malgré ses qualités théoriques, l’algorithme d’APB a suscité de nombreuses controverses :
- Le manque de transparence sur les critères de sélection utilisés par les établissements
- Le recours au tirage au sort pour départager les candidats dans les filières en tension comme STAPS ou droit
- La complexité du système avec ses 24 vœux et sa hiérarchisation obligatoire
En 2017, j’ai vu de nombreux étudiants découragés par ce système qui semblait parfois reléguer leur avenir académique à une simple question de chance dans certaines filières populaires.
Avant APB : l’évolution des systèmes d’orientation post-bac en France
Pour comprendre la révolution qu’a représentée APB, il faut se rappeler comment fonctionnait l’orientation avant 2009. Étant lycéen dans les années 2000, j’ai connu cette époque où chaque candidature nécessitait des démarches séparées.
Avant la centralisation nationale, les inscriptions s’effectuaient principalement par correspondance ou directement dans les établissements. En région parisienne, le système RAVEL (Recensement Automatisé des Vœux des ÉLèves) faisait figure de précurseur, d’abord sur Minitel (3614 RAVEL) de 1987 à 2004, puis sur internet.
Les futurs étudiants devaient souvent faire la queue dans chaque établissement pour déposer leur dossier, une procédure chronophage et inéquitable. Je me souviens des récits de mes aînés décrivant ces files d’attente interminables à l’université, parfois dès 5 heures du matin pour espérer obtenir une place dans les filières prisées.
Cette organisation fragmentée créait d’importantes inégalités territoriales dans l’accès à l’enseignement supérieur, les lycéens des zones rurales étant particulièrement désavantagés par l’éloignement géographique des établissements.
De APB à Parcoursup : les évolutions majeures du système d’admission
En 2018, suite aux nombreuses critiques et à plusieurs recours juridiques, APB a cédé sa place à Parcoursup. Ce changement a profondément modifié l’approche de l’orientation post-bac en France.
Les différences entre les deux systèmes sont substantielles. Parcoursup a réduit le nombre de vœux possibles à 10 (contre 24 pour APB) et a supprimé la hiérarchisation obligatoire des vœux, donnant plus de flexibilité aux candidats. Le controversé tirage au sort a été abandonné au profit d’une sélection basée sur des critères d’admission plus transparents.
Parcoursup a également simplifié le calendrier en instaurant une seule phase d’admission continue, plutôt que les trois phases distinctes d’APB. L’offre de formations s’est élargie à plus de 14 000 options, et l’accompagnement des lycéens dans leur orientation s’est considérablement renforcé.
Ayant accompagné des étudiants dans les deux systèmes, j’ai constaté que Parcoursup, malgré ses propres défauts, a apporté davantage de transparence dans le processus d’admission. L’ancien système, malgré ses imperfections, reste néanmoins un jalon important dans l’histoire de notre système éducatif.
- La fête nationale roumaine du 1er décembre : célébration de la Grande Roumanie - 30/11/2025 à 16h00
- APB c’est quoi ? Comprendre la procédure d’admission post-bac avant Parcoursup - 11/08/2025 à 17h24
- Papi ou Papy : quelle est la bonne orthographe pour désigner son grand-père ? - 15/01/2025 à 9h10